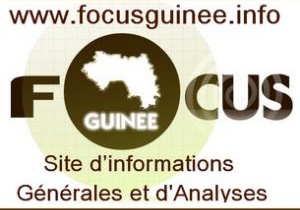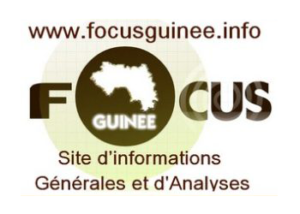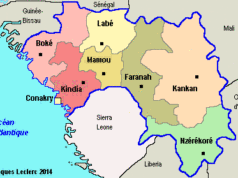ANALYSE. L’expérience d’Ebola rend la Guinée mieux outillée face au Covid-19, mais les mesures de distanciation sociale risquent de se révéler impraticables
Au mois de février, alors que l’épidémie semblait circonscrite en Chine, l’analyse des risques effectuée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires techniques avait conclu que le risque d’importation du virus en Guinée était faible. Cela n’a pas empêché les autorités sanitaires de mettre en alerte maximale les grands points d’entrée dans le pays que sont l’aéroport et le port de Conakry ainsi que les ports miniers des préfectures de Boké et Boffa. Cette réactivité s’explique en bonne partie par le souvenir encore très récent de l’épidémie d’Ebola.
Lire aussi Fred Eboko : « L’Afrique a gardé la mémoire d’Ebola »
L’expérience d’Ebola
En mars 2014, le virus Ebola avait fait son apparition en Guinée, dans le petit village de Guéckédou, une préfecture de la région sud du pays, à la frontière libérienne et sierra-léonaise. La maladie s’est rapidement propagée dans les deux pays frontaliers et a touché plus des deux tiers des préfectures de la Guinée. L’épidémie a pu être arrêtée dans le pays en décembre 2015, après avoir infecté 3 811 personnes, dont 2 543 sont mortes.
Pour lutter contre la maladie, le président de la République avait déclaré l’état d’urgence sanitaire et créé une équipe nationale de coordination de la lutte contre Ebola. Cette équipe a développé une stratégie basée sur la détection des cas, leur prise en charge, la communication et mobilisation sociale, le cerclage, la désinfection des domiciles et la recherche active des cas perdus de vue.
Les expériences accumulées dans la gestion de l’épidémie d’Ebola ont aidé à définir les actions à mener pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Au cours des réunions de coordination de la riposte contre le Covid-19, les stratégies initiées sont souvent justifiées en référence aux expériences issues d’Ebola.
Premièrement, l’équipe de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, qui avait aussi géré l’épidémie d’Ebola, a capitalisé sur cette expérience en démarrant la riposte plus tôt que pendant Ebola. En effet, pendant Ebola, le premier malade avait été confirmé, nous l’avons dit, en mars 2014, et c’est seulement au mois d’août que l’état d’urgence avait été déclaré. L’équipe de coordination pour la riposte contre la maladie avait été mise en place le mois suivant alors que l’épidémie avait déjà atteint son premier pic dans la région sud du pays.
Cette fois-ci, la coordination est mieux organisée autour de l’Agence, avec des pouvoirs renforcés par un décret présidentiel pour empêcher les conflits de leadership.
De plus, l’une des conséquences de l’épidémie d’Ebola a été le renforcement du système de santé avec le développement de la santé communautaire. En 2014, Ebola avait révélé au grand jour la faiblesse du système de santé guinéen. Le président a demandé l’organisation d’états généraux de la santé en vue d’établir une analyse situationnelle du système de santé. Les recommandations issues de ces travaux ont fait du développement de la santé communautaire une priorité du gouvernement.
Cette priorité a été inscrite dans la politique nationale de santé et dans le nouveau plan décennal de développement sanitaire 2015-2024, qui vise à améliorer l’accès et l’utilisation des services de santé.
Les recommandations stratégiques actuelles contre le Covid-19 encouragent fortement l’utilisation de ce dispositif public qui semble plus pérenne.

L’expérience tirée de la lutte contre Ebola en Afrique permet d’examiner toutes les modalités de la riposte, notamment de mieux comprendre les réticences de certaines communautés face aux acteurs de la riposte.
Enfin, au lieu d’engager une campagne nationale d’emblée, les enseignements d’Ebola ont permis de privilégier, avec la mise en place de plateformes dans les préfectures, une « approche risque » consistant à identifier progressivement les zones d’intervention.
Lepoint.fr