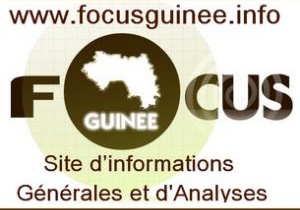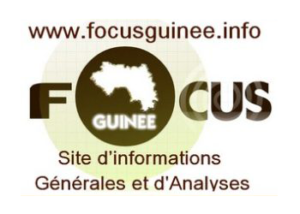Entre les feux croisés des bandes armées qui mettent plusieurs parties du continent à feu et à sang, la riposte souvent brutale et peu orthodoxe des armées régulières, les doutes sur les missions assignées aux forces d’interposition et leur efficacité, le travail des organisations de défense de droits humains est tout sauf une sinécure. La multiplication des conflits en Afrique implique des intérêts locaux et internationaux pas toujours identifiés, ce qui rend forcément les choses très complexes.
C’est une « sale guerre » qui se déroule entre des groupes djihadistes et les pays du Sahel depuis plus d’une décennie. Celle-ci impacte ou implique de temps à autres des États du Maghreb attenants qui, eux-mêmes, sont déjà confrontés à des conflits multiformes sur le plan intérieur. Mais surtout, les conflits armés de cette nature tendent de plus en plus à déborder sur d’autres pays plus au sud de la bande sahélienne et à y installer un climat de violence permanent, fait d’attentats, de razzias, d’annexion de territoires, de ripostes gouvernementales et de violations des droits humains par toutes les parties en présence.
La guerre dans les points chauds en Afrique est asymétrique et barbare. L’ennemi – qu’on assimile un peu trop hâtivement à des groupes djihadistes – est furtif et difficile à identifier avec certitude. Car, il n’y a pas de ligne de front. Les attaques sont perpétrées au gré des nombreuses opportunités qu’offrent les failles des lignes de défense des forces régulières. Les cibles, elles, ne sont pas toujours militaires. Le sang qui coule est surtout celui des innocents. Et toutes les atrocités commises ne parviennent même plus à choquer les esprits engourdis. Les populations plongées dans la psychose ont fini par développer une forme de résilience, face aux flux importants d’informations et d’images pour le moins insoutenables qu’elles reçoivent à travers les journaux télévisés, la presse écrite ou en ligne, les réseaux sociaux, etc.
Pourtant, malgré la flagrance des nombreux cas de violation des droits humains dans cette zone, dresser leur constat et en établir les responsabilités est une mission quasiment impossible pour les organisations de défense des droits humains. Le climat d’insécurité, porté à son comble dans les zones de conflits ou d’attaques sporadiques, « empêche toute présence des enquêteurs sur le terrain », affirme Jonatthan Pedneault de la division Crises et conflits de l’ONG Human Rights Watch. Une situation qui, du reste, s’est aggravée avec l’arrivée de la pandémie Covid-19.
Le pire dans cette situation, c’est surtout la coopération non garantie des gouvernements. Très souvent, ces derniers se montrent hostiles lorsque des actes de violation des droits humains impliquent leurs forces armées. « Plusieurs gouvernements, malheureusement, ont la réputation de ne pas être spécialement sympathiques vis-à-vis des organisations de défense des droits de l’Homme », affirme encore Jonatthan Pedneault. Il ajoute que « les enquêtes, cependant, se poursuivent la plupart du temps sans forcément compter sur leur collaboration, ni sur leur bonne foi. C’est un processus qui peut être long. Il faut mesurer les risques, faire preuve de patience et de beaucoup d’ingéniosité pour mener des enquêtes. Nous devons prendre le temps de vérifier les informations par le biais de nos avocats à New-York et de recouper les sources entre les voix officielles, celles des victimes et des témoins ». À ce long processus, il faut adjoindre le temps des procédures pour requérir l’intervention d’organisations internationales à l’instar de l’ONU, de l’Union Européenne, de l’Union Africaine, ou encore d’autres instances gouvernementales ou non qui ont la capacité d’exercer quelques pressions.
Les ONG parviennent toutefois à obtenir des résultats satisfaisants. Jonatthan Pedneault cite en exemple le Soudan du Sud où l’action des organisations de défense de droits humains a pu contribuer à l’emprisonnement d’Omar El Béchir. Il cite également entre autres le Darfour, avec l’arrestation de certains membres de la hiérarchie militaire qui étaient soupçonnés d’avoir ordonné ou participé à des crimes de guerre.
Cependant, on est loin de se satisfaire des résultats, compte tenu des efforts qui sont considérables la plupart du temps. Il y a, à côté de ces quelques victoires, des cas comme celui du Cameroun où la situation reste préoccupante dans la zone anglophone du pays, avec des exactions commises par les forces régulières sur des populations civiles.
Plus récemment, Human Rights Watch a demandé l’ouverture d’une enquête à la suite d’une vidéo ayant circulé sur les réseaux sociaux et qui montrait des soldats nigériens roulant avec des véhicules militaires sur deux individus blessés et apparemment désarmés. Le Niger a confirmé les faits qui se sont déroulés lors d’une opération militaire contre Boko Haram le 11 mai 2020, au sud de Diffa, près de la frontière avec le Nigeria. Cependant, le gouvernement nigérien balaie d’un revers de la main les accusations de « crimes de guerre » et soutient que l’armée nigérienne « ne devrait pas être jugée sur la base de cet incident ». Des cas de figures comme ceux-là font légion.
Un argument islamiste qui sert de cache-sexe ?
Les victimes collatérales de tous ces conflits sont généralement de pauvres paysans qui ne demandent qu’à mener paisiblement leur vie champêtre, même si les attaques contre des cibles militaires sont également nombreuses. Sous prétexte de fondamentalisme religieux ou de représailles contre la politique menée par les États, des villages entiers sont dévastés, des hommes sont tués, des femmes violées, des écoles saccagées… Toutes ces razzias n’épargnent pas les enfants qui, au même titre que les adultes, sont souvent accusées d’être des mécréants.
Pourtant, à bien y regarder, le fondamentalisme religieux dans ces zones donne toutes les apparences d’un arbre qui cache la forêt. Les actions terroristes menées par des bandes armées qui se multiplient comme de la mauvaise herbe dans la région, ont visiblement des motivations qui s’éloignent de l’argument religieux. Sur la base de ce qui s’observe sur le terrain, ces groupes se réclament en effet de confessions religieuses, la plupart du temps de la foi islamique. Plus rarement les conflits prennent des tournures ethniques, comme cela est le cas avec de nombreuses factions Touaregs du Mali dont l’Azawad qui a annexé la moitié nord du territoire et favorisé de nombreuses attaques de groupes djihadistes dans la partie sud. Dans le même cas de figure, on compte Boko Haram au Nigéria, les forces démocratiques armées (ADF) en RDC, la LRA (Armée de résistance du seigneur) de Joseph Kony en Ouganda, RDC et au Sud Soudan, ou encore plus au nord-ouest de la RDC, les Séléka et des Anti-Balaka en Centrafrique.
À la grande différence des attentats commis par d’autres factions djihadistes dans les pays occidentaux, les actes posés n’ont pas toujours un rapport strict avec les revendications relatives au conflit Israélo-Palestinien, ou même avec le djihad à proprement parler ; c’est-à-dire : une « guerre sainte » menée pour « propager ou défendre l’islam ». Ici, le djihad ou « l’effort que doivent fournir les musulmans pour rester dans le droit chemin et combattre les ennemis de l’islam » prend plutôt des allures de crime organisé.
Depuis l’élimination de Mouammar Kadhafi le 20 octobre 2011, les bandes armées qui se sont multipliées au Sahel et dans le Maghreb surprennent par la supériorité des moyens militaires et logistiques dont elles disposent face aux armées régulières. Plusieurs d’entre elles naissent et disparaissent sans laisser de traces, vraisemblablement pour se reconstituer sous d’autres formes. C’est ainsi que tour à tour, on en a connu sous diverses appellations : Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC 2003-2007) ; Boko-Haram (depuis 2009) ; Mujao (2012-2013), Ansaru (depuis 2012) ; les signataires par le sang (2012-2013) ; Ansarul Islam (depuis 2016) ; État islamique dans le Grand Sahara (2015-2019) ; Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) ; Al-Shabbaab … Un foisonnement et une force de frappe qui interrogent sur le caractère spontané supposé de leur apparition et aussi sur l’argument religieux dont ils se revendiquent la plupart du temps.
Intrigues sur l’efficacité des forces d’interposition
À l’observation, les actions conjuguées des groupes armés ont un point commun : la déstabilisation des États dans lesquels ils opèrent. Qu’ils s’appellent rebelles, sécessionnistes, islamistes ou autres, ces terroristes créent presque de manière systématique des zones de non droit autour de sites réputés contenir des matières premières hautement stratégiques qu’ils soustraient au contrôle des États. Un fait récurrent qui fait penser que l’argument religieux pourrait n’être qu’un cache-sexe. Des faisceaux de présomption font planer sur ces groupes armés des soupçons de connivence avec des multinationales, ou même avec des puissances étrangères dont les intérêts sont avérés dans ces différentes zones. Ceci d’autant plus que face à cet ennemi pour le moins insaisissable, les armées nationales sont quasiment en déroute. Souvent, pour ne pas perdre la face, les forces gouvernementales procèdent ici et là à quelques frappes dans le camp de l’ennemi. Et leurs autorités de tutelle s’arrangent pour que cela se sache. Mais, vraisemblablement, il ne s’agit guère là que d’opérations de communication entreprises en désespoir de cause. Plutôt que de montrer l’efficacité des actions de force de défense nationale, ces opérations révèlent bien plus leurs insuffisances.
Mais alors, une question taraude les esprits : et les forces d’interposition internationales dans tout ça ? Essentiellement françaises – du moins pour ce qui concerne le Sahel et certaines régions d’Afrique centrale – ces forces peinent à endiguer les attaques terroristes dans les zones où elles interviennent. Celles-ci sont pourtant supposées être mieux entraînées et mieux équipées. Mais elles ne semblent pas vraiment impressionner les djihadistes. Visées elles aussi par les attaques récurrentes de ces derniers, les forces françaises comptent des pertes militaires importantes au Mali et au Sahel. Au 24 juin 2020, celles-ci s’élevaient à 46 militaires tués depuis 2013, dont 8 officiers, 2 officiers mariniers, 17 sous-officiers et 19 militaires du rang.
Sur les théâtres d’opérations, les plus grandes pertes sont toutefois essuyées par les armées régulières. Au Mali comme au Niger et au Burkina Faso, les attaques contre des cibles civiles et militaires font encore plus de victimes. Celle perpétrée le dimanche 14 juin au Mali dans la localité de Bouka Weré, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne sur un convoi militaire fort de 64 soldats, s’est soldé par un lourd bilan. Une quarantaine d’entre eux ont été déclarés morts ou disparus.
Sur cette multiplication des zones de conflits en Afrique, l’Union Africaine reste inaudible. L’absence d’une force d’interposition africaine frise le ridicule, tout comme la débâcle des armées nationales qui manquent de tout, leur efficacité n’étant visible que du point de vue de la répression des contestations sociales et populaires.
Inévitablement, la grogne des populations s’intensifie et des voix s’élèvent, dénonçant clairement un « complot de l’impérialisme néocolonialiste de la France ». À Bamako au Mali, de nombreux rassemblements de Maliens réclament depuis plusieurs mois le départ du Mali de la force française Barkhane. Sur une vidéo mise en ligne par nos confrères de France 24, le 11 janvier 2020 déjà, on pouvait voir un manifestant déclarer au milieu d’une foule déchainée : « La France a un seul but, c’est de déstabiliser notre pays, de déstabiliser notre armée ». Et, ces dernières semaines, ce sont des milliers et des milliers de Maliens qui, à l’appel de l’Imam Mahmoud Dicko, réclament la démission d’Ibrahim Boubacar Keïta accusé d’être « un pion de la France ». Mais le cas du Mali n’est pas isolé.
Le sentiment que « l’Afrique francophone reste un pré-carré français » s’est installé dans les esprits. Il en est de même pour la défiance contre la plupart des « présidents mal élus » des différents pays de cette partie de l’Afrique dont beaucoup sont publiquement dépeints comme des « gardes-chiourmes qui servent leur maître occidental ».
La colère des populations n’épargne pas les ONG
Dans la grogne qui monte parmi les populations en Afrique, celle contre les ONG et, notamment, les organisations qui officient dans la défense des droits humains, n’est pas en reste. Beaucoup parmi les activistes qui se lèvent ici et là sont convaincus que les ONG recevant des soutiens et des financements des puissances occidentales, ne peuvent pas être neutres dans leurs interventions sur les zones de conflits. Certains n’hésitent plus à les accuser ouvertement d’espionnage ou, tout au moins, de connivence avec des forces qui pourraient avoir des intérêts dans les zones de conflits.
« Cela s’est déjà vu ailleurs », affirme un militant panafricaniste basé à Paris qui requiert l’anonymat. Il poursuit en indiquant un article mis en ligne le 27 octobre 2015 par Le courrier international au sujet d’un financement de plusieurs millions de dollars que le Pentagone aurait octroyé à un programme secret d’espionnage de la Coré du Nord, sous le couvert de l’activité du Humanitarian International Services Group (HISG). Il cite également une enquête commandée par IRIN, le réseau d’informations régionales intégré, spécialisé dans l’analyse de l’action humanitaire, sur la société Palantir, en lien avec le renseignement. Cette dernière, souligne-t-il, aurait d’après cette enquête, « approché des organisations d’aide humanitaire de toutes tailles ». Selon lui, « sur la base de ces pratiques qui sont coutumières des grandes puissances et des magnas de la haute finance internationale, il n’y a pas de raison qu’une telle réalité ne s’applique pas à des ONG qui proposent leurs services dans des zones où plusieurs puissances occidentales s’activent à déstabiliser les pays africains, afin de spolier des richesses de leurs sous-sols ».
Cette prise de position est d’ailleurs corroborée par les propos de Michael Barry, écrivain américain et professeur au département d’études proches orientales à l’université de Princeton. Dans une tribune publiée le 6 novembre 2001 par le journal Libération, il déclarait en effet en parlant d’une ONG accusée d’espionnage en Afghanistan, que la priorité dans ce pays était de « remplacer au plus vite le régime mortifère des talibans par un gouvernement civilisé », ajoutant que « l’humanitaire n’a jamais été séparé du politique ».Autant de faits qui jettent le doute sur l’indépendance des ONG et la pertinence de leurs activités exclusivement humanitaires en Afrique.
La mission humanitaire – dans ce contexte où s’entremêlent des intérêts et des enjeux pas toujours évidents pour l’observateur lambda – est-elle une imposture ou tout simplement une mission impossible ? Interrogé sur cette question, Ida Sawyer, directrice par intérim de la division Crises et conflits de Human Rights Watch, a rejeté toute comparaison avec les activités de cette organisation de défense des droits humains en Afrique ou ailleurs : « Nous nous appliquons à nous assurer que les financements que nous recevons ne proviennent ni des États, ni des sources susceptibles d’être impliquées dans des conflits d’intérêts où les droits humains sont en cause ». C’est dit avec la plus grande fermeté. Reste, cependant, à en convaincre les populations africaines et les activistes de plus en plus nombreux qui, eux, semblent convaincus du contraire. Pour autant, on ne peut cependant pas nier qu’un grand nombre d’ONG apportent aux populations des aides inestimables et des solutions que les gouvernements de leurs pays respectifs ne leur garantissent plus depuis …