
Donald Trump a récemment exprimé sa volonté de mettre fin à l’aide publique au développement, une position qui provoque une onde de choc à travers le continent africain, et particulièrement en Guinée. Toutefois, cette perspective résonne d’une manière particulière dans les paroles visionnaires de Thomas Sankara, l’ancien président du Burkina Faso, qui affirmait en 1987 :
« Nous estimons que la dette s’analyse d’abord de parson origine. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l’argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos économies. »
Là où Sankara voyait une continuité du colonialisme sous une forme nouvelle, aujourd’hui, la voix de Trump résonne comme un aveu brutal de la fin de l’illusion d’une aide bienveillante. Trump n’est qu’un reflet de cette vieille mécanique coloniale, où l’aide est un instrument de soumission et de contrôle. Le jeune président du « pays des hommes intègres » poursuivait :
« La dette c’est encore le néo-colonialisme ou les colonialistes qui se sont transformés en « assistants techniques ». En fait, nous devrions dire en assassins techniques. »
Cette analyse implacable résonne plus que jamais à l’heure où la Guinée, à l’instar de la plupart des pays d’Afrique, malgré l’injection de milliards de dollars, reste accablée par les crises économiques, les inégalités sociales, et un système politique gangrené par la corruption. L’aide publique au développement, loin de nourrir le véritable développement, a souvent perpétué la dépendance et le sous-développement.
Les bailleurs de fonds internationaux – USAID, AFD,FMI, Banque mondiale – imposent des réformes inadaptées, tournées vers une ouverture à l’international et une spécialisation dans la production de matières premières. Mais ces réformes n’ont servi qu’à maintenir nos nations dans une position subordonnée, stérile et dépendante. Au lieu d’un développement, nous avons vu l’émergence de « éléphants blancs » : des projets et infrastructures coûteux, inefficaces, souvent déconnectés des besoins réels des populations.
En Guinée, cette dépendance a conduit à une mauvaise gouvernance, une corruption systémique et un détournement massif des fonds de développement. Les riches ressources naturelles du pays, au lieu de devenir un levier de prospérité, sont devenues une malédiction. Pourtant, certains osent encore parler de la Guinée comme d’un paradis, un mirage où tout semble possible, mais ce paradis n’est qu’une illusion, une façade qui masque la réalité cruelle d’une population écrasée sous le poids de l’injustice et de la misère. Pendant ce temps, des générations de jeunes, sans espoir, cherchent désespérément à fuir cette terre promise d’illusion, inondant les villes, nourrissant les requins de la Méditerranée, traversant le désert du Sahara comme une route de désespoir, ou se noyant dans l’oubli des migrations.
Il est grand temps de rompre ce cycle. Nous avons besoin de moins de dons et de plus d’investissements. Nous appelons à la responsabilité et à l’autodétermination. Il nous faut diversifier nos productions, stabiliser nos populations et développer des modèles de croissance durable qui respectent l’environnement et nourrissent nos enfants. Nous devons bâtir une économie verte et résiliente, sans les chaînes invisibles des bailleurs de fonds.
L’aide internationale telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui est une nouvelle forme de colonisation, déguisée en bienveillance. Pour se libérer, la Guinée doit couper les liens d’une dépendance étrangère et tracer son propre chemin vers l’avenir. Les réformes internes et les investissements ciblés, non dictés mais choisis avec sagesse, sont la clé pour ouvrir la porte d’une Afrique libre et autonome.
Comme le disait notre père de l’indépendance, le président Ahmed Sékou Touré :
« Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l’esclavage. »
Ces mots résonnent aujourd’hui avec une force décuplée. Notre indépendance ne sera complète que lorsque nous serons maîtres de notre économie, de nos ressources et de notre destin.
Le Président Alpha Condé, lors de la Conférence sur l’émergence de l’Afrique en 2017, exprimait ce besoin impérieux de nous détacher de nos anciennes chaînes :
« Nous sommes encore trop attachés à la puissance coloniale. Il faut couper le cordon ombilical. »
Nous devons, une fois pour toutes, briser ce cordon et prendre les rênes de notre avenir avec audace et responsabilité.
L’aide au développement actuelle est semblable à un pansement temporaire sur une plaie profonde, une illusion de guérison. La Guinée, comme un arbre en terre aride, doit se déployer vers le ciel, s’ancrer dans la terre de ses ressources et se nourrir de la sève de ses propres efforts. Ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra offrir un fruit véritablement sucré : celui de la prospérité et de la liberté.
Le général Mamadi Doumbouya, lors du 78e sommet des Nations unies, a souligné une vérité douloureuse :
« L’Afrique souffre d’un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l’Occident qui l’a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à s’adapter à nos réalités, à nos coutumes, à notre environnement. Hélas, la greffe n’a pas pris… »
Cette déclaration frappante illustre l’échec du système imposé. Pourtant, certains jugeront encore cette remise en question comme l’attaque d’un « bidasse qui veut tordre le cou à la démocratie« . Mais la véritable question qui se pose est la suivante : peut-on encore croire que l’aide internationale est une solution quand les lendemains sont de plus en plus sombres ? Peut-on vraiment bâtir un avenir prospère sous perfusion ?
Ousmane Boh KABA in mediaguinee
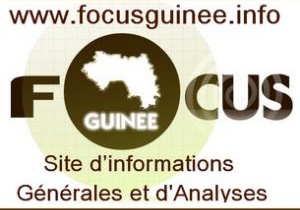
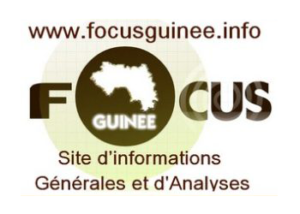






![Pauvreté sous perfusion : Trump met fin à l’illusion de l’aide au développement [Par Ousmane Boh Kaba]](https://focusguinee.info/wp-content/uploads/2025/02/usaid-100x75.webp)

