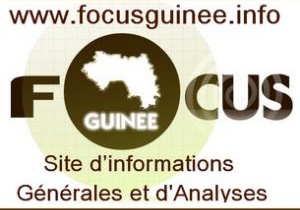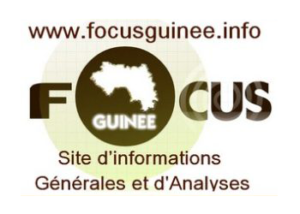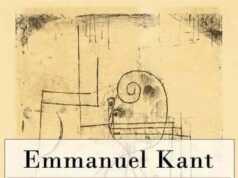La prétendue indépendance absolue des médias vis-à-vis du monde politique relève davantage du mythe que d’une réalité tangible. Une observation attentive de l’histoire des grands médias français permet de comprendre que le journalisme, loin d’évoluer en vase clos, s’est toujours construit en interaction – parfois en tension, souvent en symbiose – avec les forces politiques.
Prenons l’exemple du Figaro, fondé en 1826, qui s’est rapidement imposé comme le porte-voix de la droite conservatrice, puis gaulliste, avant d’être acquis par la famille Dassault, très engagée à droite. L’évolution du journal suit de près les courants idéologiques qui ont façonné la droite française. Il en est de même pour Libération, né dans l’effervescence post-68 sous l’impulsion de Jean-Paul Sartre, matrice d’un journalisme engagé et critique du pouvoir, mais toujours connecté aux grands débats politiques de la gauche française.
Le Monde, quant à lui, est un cas d’école. Fondé à la demande du Général de Gaulle, il s’érige rapidement en journal de référence, humaniste et modérément de gauche. Il joue un rôle de premier plan dans la structuration de l’opinion publique éclairée, souvent en interaction avec les élites politiques et intellectuelles du pays.
Même L’Humanité, fondé par Jean Jaurès, revendique sa proximité avec le Parti communiste français. Son influence, bien que déclinante, demeure forte dans certains milieux militants, précisément en raison de cette continuité idéologique.
Mediapart, de son côté, s’est hissé au rang de vigie de la République en multipliant les révélations, tout en assumant une posture critique envers les institutions, souvent en phase avec la gauche radicale.
Aucun de ces médias ne peut être compris sans analyser les rapports de force politiques qui les sous-tendent : propriétaires influents, financements croisés, logiques éditoriales, tous les marqueurs de la presse sont imbriqués dans le champ politique. L’idée d’un journalisme « pur », détaché de toute influence, est une illusion. Le financement même de l’audiovisuel public, comme France Télévisions, demeure soumis à des arbitrages politiques.
Ainsi, les médias ne sont pas des tours d’ivoire ; ils sont des acteurs de la démocratie, en interaction constante avec le pouvoir politique. Cette interaction n’est pas un vice – elle est une nécessité. Car ce sont les politiques qui façonnent l’espace de la liberté d’expression, les régulations sur les médias, les subventions à la presse, et même les grands débats qui font vibrer les rédactions.
Sans les politiques, pas de pluralisme. Sans les politiques, pas de combat pour la liberté de la presse. Et sans les médias, pas de contre-pouvoir efficace. Cette dynamique, bien qu’imparfaite, reste au cœur du progrès démocratique.
Alors oui, le journaliste peut critiquer le politique, mais il ne peut s’en affranchir. Il en est le miroir, le partenaire, parfois l’adversaire. Toujours, il en est l’écho.
Par Aboubacar SAKHO
Juriste-journaliste