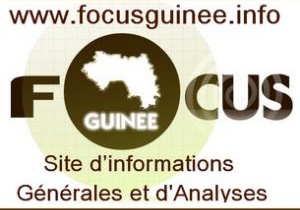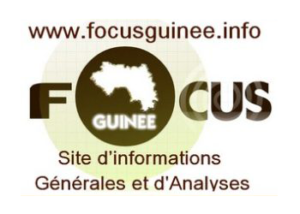Il est des silences qui tuent, des lenteurs administratives qui enterrent vivants, des démissions d’État qui confinent au crime collectif. La décharge de Dar-es-Salam, dans la commune de Ratoma, n’est plus un simple dépotoir, c’est un charnier moderne à ciel ouvert, une chambre à gaz urbaine tolérée, légitimée, entretenue par une indifférence politique qui suinte la corruption et le mépris. Deux morts de plus : l’imam Abdoul Karim Sylla, et Hadja Gallé Barry. Deux morts de trop. Deux vies emportées par des vapeurs assassines, les poumons asphyxiés par la toxicité d’un système qui n’a jamais voulu assainir autre chose que son discours.
Il faut oser le dire : la décharge de Dar-es-Salam est une structure d’homicide involontaire à répétition, conçue par l’incurie et stabilisée par le déni. Elle n’a rien d’un site de traitement des déchets moderne. Elle est le résultat d’un urbanisme anarchique, d’une planification absente, d’une ingénierie politique du pire. Depuis des décennies, ce site accueille sans distinction les ordures ménagères, les déchets biomédicaux, les débris industriels, dans une promiscuité environnementale criminelle. En saison sèche, une fumée noirâtre et âcre s’élève quotidiennement, comme l’encens funèbre d’un État en putréfaction. En saison des pluies, les eaux usées ruissellent en torrents infects dans les quartiers adjacents, charriant les germes de la mort dans chaque ruelle, chaque concession, chaque trachée d’enfant.
𝐂𝐞 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́. 𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧 𝐜𝐡𝐨𝐢𝐱.
Un choix fait par des autorités qui, depuis les premières alertes lancées par les riverains, ont préféré bétonner l’oubli que consolider des solutions. Car la délocalisation de cette décharge n’est pas un casse-tête technique, c’est un refus politique. Il ne s’agit pas ici de méconnaissance des risques — car les rapports sont légion, les expertises abondantes, les précédents documentés. Il s’agit de négligence calculée. De cette négligence qui ne produit pas de chiffres électoraux, mais des bilans funèbres.
Sur le plan technique, toute plateforme de stockage d’ordures de cette envergure en milieu urbain nécessite, selon les normes minimales du génie civil environnemental, un site à l’écart des zones d’habitation, une imperméabilisation du sol, un réseau de drainage des lixiviats, un système de captation et de traitement des biogaz, un suivi géotechnique en continu pour prévenir les glissements de terrain. Qu’a fait l’État ? Rien de tout cela. La décharge de Dar-es-Salam s’érige sans géomembrane, sans bassins de décantation, sans torchère pour brûler les gaz, sans surveillance des mouvements de masse. Et quand la pluie tombe, c’est la terre elle-même qui vomit sa détresse, engloutissant des maisons, des enfants, des espoirs.
𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧 𝐞𝐟𝐟𝐨𝐧𝐝𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞́. 𝐔𝐧 𝐞́𝐛𝐨𝐮𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬. 𝐔𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐥.
Combien faudra-t-il de cercueils supplémentaires pour que cette décharge soit déplacée ? Combien de toux sèches, d’asthmes chroniques, de décès prématurés faudra-t-il enregistrer pour que les décideurs comprennent qu’on ne gère pas une ville comme un dépotoir ? Que la vie des habitants de Dar-es-Salam vaut autant que celle des résidents des quartiers huppés de la capitale ? À moins que dans l’arithmétique macabre de la gouvernance guinéenne, le prix d’un pauvre soit déjà fixé : gratuit.
Mais la conscience technique ne peut rester neutre face au désastre. Le rôle de l’ingénieur n’est pas seulement de calculer les charges et de poser des fondations. C’est aussi de dénoncer quand une structure menace, quand une ville s’étouffe, quand une société s’écroule faute de volonté politique. Il faut le dire hautement : la République de Guinée a failli. Elle a failli à ses devoirs d’assainissement, de prévention, de justice environnementale.
Dar-es-Salam n’est pas un accident. C’est un verdict. Celui d’un État qui laisse pourrir les vivants avant même qu’ils ne meurent.
AF