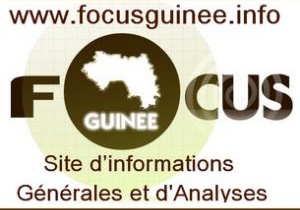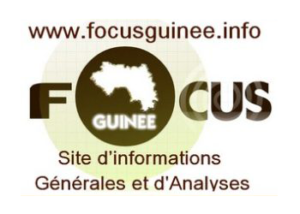Union africaine : le mirage panafricain face au sursaut des peuples libres !
Par Abdoulaye Sankara (Abou Maco) journaliste
Aujourd’hui, 25 mai, l’Afrique célèbre sa journée mondiale, en souvenir de la naissance de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) à Addis-Abeba en 1963, devenue Union africaine (UA) en 2002. Mais peut-on encore parler d’unité africaine lorsque l’institution censée incarner la voix des peuples est plus préoccupée par les intérêts de ses bailleurs que par ceux du continent ? À l’image du célèbre « machin » dénoncé par le général de Gaulle à propos de l’ONU, l’Union africaine inspire aujourd’hui un profond désenchantement.
Une institution sous perfusion étrangère
À bien des égards, l’Union africaine est devenue l’ombre d’elle-même. Financée à plus de 60 % par des partenaires extérieurs — Union européenne, Chine, Banque mondiale, et même des États du Golfe —, elle est prisonnière de logiques étrangères à celles des peuples africains. Difficile, dans ces conditions, d’espérer des positions courageuses face aux interventions extérieures, aux coups d’État masqués ou aux sanctions iniques imposées à des États aspirant à l’autodétermination.
L’exemple le plus criant reste celui des pays de l’AES (Burkina Faso, Mali, Niger), qui, en rupture avec l’ordre néocolonial, paient le prix fort de leur volonté de souveraineté. Ces États, qui ont osé dire non à la domination militaire et économique, ont été rapidement isolés, sanctionnés, puis exclus par des institutions africaines devenues gardiennes d’un ordre ancien. L’Union africaine, plutôt que d’engager le dialogue, a suivi docilement les injonctions de la CEDEAO, elle-même de plus en plus perçue comme une succursale de certaines puissances étrangères.
La trahison des élites intégrées
Au fil des années, l’Union africaine s’est muée en une enceinte diplomatique stérile, où se croisent des chefs d’État déconnectés des aspirations populaires. Combien de résolutions sans suite, de sommets sans impact ? L’UA, censée incarner un panafricanisme de combat, s’est embourbée dans un langage technocratique qui masque son absence d’audace et de vision. Là où les peuples attendent des ruptures, elle propose des rapports. Là où il faut trancher, elle tergiverse.
Ce n’est pas une question de moyens, mais de volonté politique. Car lorsque l’histoire frappe à la porte, certains peuples n’attendent pas l’aval de commissions pour se libérer. Le réveil des nations africaines, que ce soit dans l’AES, même en Guinée, au Tchad ou ailleurs, traduit une impatience : celle d’en finir avec les tutelles, les conditionnalités, les humiliations. Ces États ne rejettent pas l’intégration africaine, ils refusent une Union africaine sous influence.
Vers une autre Afrique, debout et solidaire
Il est temps que l’Union africaine fasse sa mue. Soit elle choisit d’écouter les peuples, de défendre réellement les intérêts africains, d’admettre la pluralité des trajectoires vers la souveraineté ; soit elle continuera à perdre en crédibilité et en légitimité. Les peuples, eux, avancent. L’intégration africaine ne se fera plus au sommet, mais à la base, entre nations debout, solidaires, libérées des complexes et des carcans postcoloniaux.
En ce 25 mai, l’Afrique n’a pas besoin de commémorations creuses, mais d’un véritable aggiornamento panafricain. L’espoir, lui, ne meurt jamais. Dans les rues de Tripoli, de Bamako, de Niamey, de Ouagadougou, de Lomé, d’Accra, de Ndjamena ou de Conakry, il porte un nom : souveraineté. Et ce combat-là ne se négocie pas. Il se gagne. Ensemble.
Je suis Panafricain !
Je viens en Panafricain !
Je repars en Panafricain !